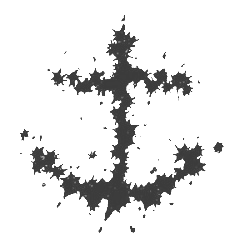Déserter
Un livre de Mathias Énard
« La guerre c’est rincer ses godasses dans des flaques ». Ce livre est l’histoire de la trajectoire de deux hommes, lointains l’un à l’autre, mais qui ont tous deux été confrontés à l’alternative : continuer ou déserter. Des hommes pris « dans la direction du destin ».
Le premier homme est un déserteur – « personne n’est de son camp, son camp n’existe pas » – qui a fait une guerre près de chez lui ; on ne peut s’empêcher de penser à la guerre en Ukraine contre l’envahisseur Russe.
Il porte des « vêtements cartonnés par la crasse » et se trouve pris dans une « violence parfaite ». Il n’est pas un déserteur de principe : il a fait la guerre, pendant trois ans. Mais il a fini par déserter. Maintenant, « C’est son fusil qui le porte et le guide, aiguille démesurée d’un compas magique, bâton d’un sourcier de mort ». C’est un homme avec lequel l’auteur réussit à nous faire entrer en empathie, alors que l’on devine dès le début la brutalité dont il a été capable. En fuyant, l’homme rencontre une femme et un vieil âne borgne qui le fuient par peur de sa violence. Mais cette tragédie ne se réalisera pas.
Le deuxième homme est un mathématicien – « princes de l’abstrait » – « têtu comme un axiome », stalinien orthodoxe fidèle au souvenir de ses compagnons de camp de concentration, mais aussi au régime de l’Allemagne communiste d’après-guerre. Un homme pour qui la capitale du monde est devenue Moscou, qui marchait sur deux jambes, « l’algèbre et le communisme ». Son destin est raconté par sa fille, historienne des mathématiques.
Le camp de Buchenwald, construit à l’endroit même où Goethe se promenait en son temps, structure toute la vie cet homme, avec l’algèbre. Il travaille sur un magnifique mystère que tout le monde a sous les yeux et dont la simplicité décuple l’étrangeté : la répartition des nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97… quel est le mystère de leur distribution ? Par la trajectoire du mathématicien communiste c’est aussi le rapport de l’Allemagne aux camps Nazis qui est évoqué. Une anecdote illustre la perdition allemande, une nation qui a donné certains des plus grands poètes et a sombré dans la barbarie : le poète Schiller, natif de Weimar, bien qu’il soit mort en 1805, n’a « pas complètement échappé aux camps de concentration. Il y séjourna aussi » : des déportés ont été contraints de reproduire, dans le camp de Buchenwald, les meubles de la chambre où il vécut et écrivit.
Mathias Énard fait souvent de très belles phrases, malgré la tragédie : « La rivière était l’expression même de cette mélancolie, sa plus belle métaphore : ce que nous regardons disparaître, ce qui s’enfuit vers le grand tout de l’océan en produisant une beauté verte, fluide, irisée, interminable, toujours présente et jamais identique. Dès le lundi, sur la Havel entre Spandau et Potsdam, cette mélancolie me clouait sur mon transat, avec le soleil ». Ou encore, lorsque même les éléments semblent les poursuivre : « l’âne s’est remis à braire, il se plaint de la grêle, il se plaint de cette foule douloureuse sur son dos ».
Un mathématicien capable d’amour, mais qui ne déserte pas ; un soldat qui a tué, tue – « tu ne sais rien d’autre qu’abattre, tu ignores tout des ânes et des animaux, ils ont l’innocence de leur bestialité, pas toi, tu t’enroules dans la brutalité comme dans un manteau » – mais a su déserter : ce livre évoque les dilemmes de l’éthique personnelle prise dans le fracas de l’histoire.
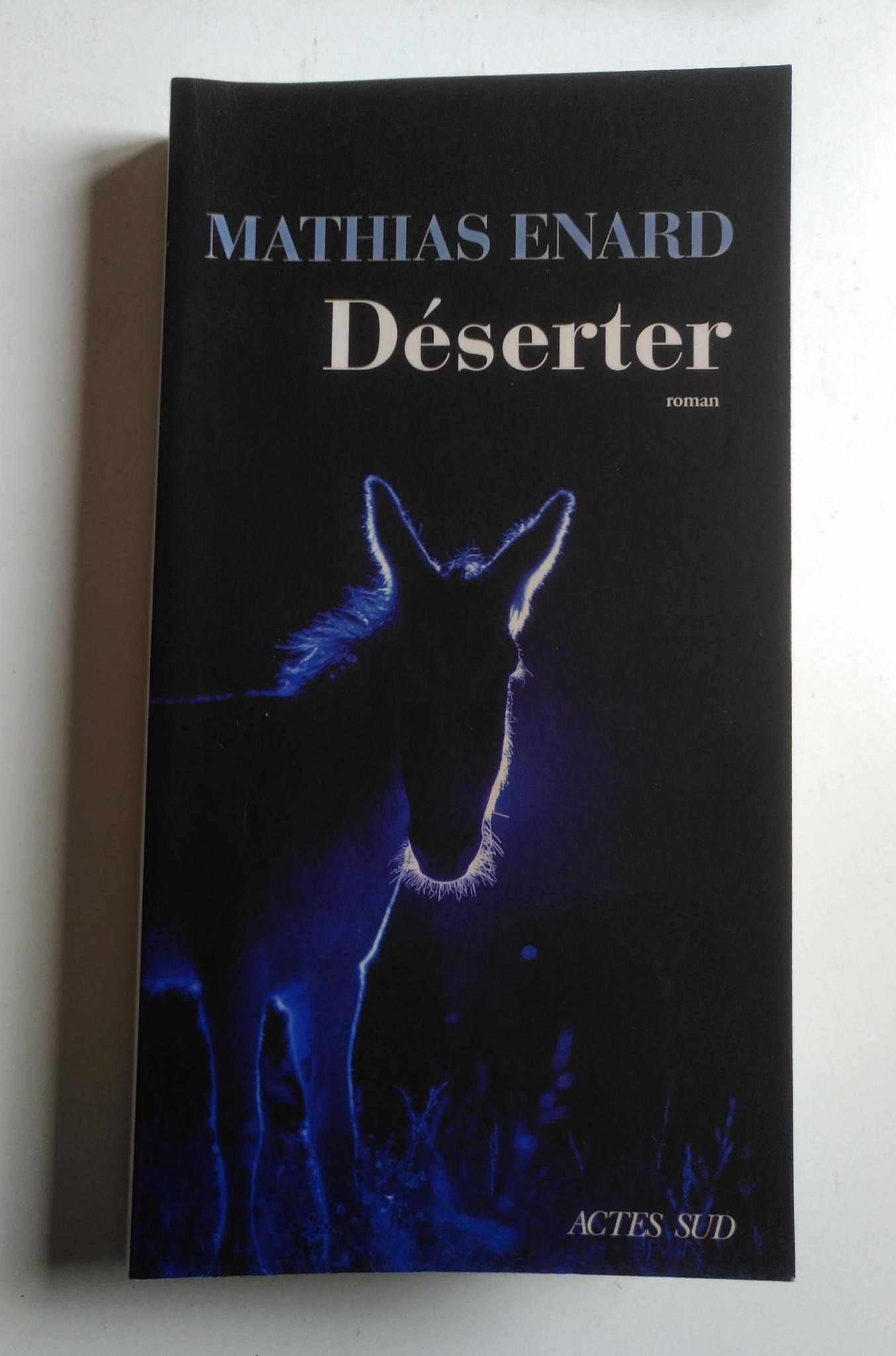 Le mathématicien, un « génie triste », écrira un texte qui relève à la fois « de la poésie et de la musique secrète des mathématiques », « Les conjectures de Buchenwald ». Que j’aurais aimé lire ce texte ! Peut-être y développait-il une sorte de mystique : « J’ai parfois l’impression […] que nous sommes tous reliés les uns aux autres comme une suite de nombres, sans que nous comprenions très bien comment ». La beauté absolue et abstraite des mathématiques, leur incroyable adéquation à décrire le monde, l’une des seules mystiques à laquelle je veux bien adhérer, les soirs de fatigue et quand me saisissent des éclairs de misanthropie.
Le mathématicien, un « génie triste », écrira un texte qui relève à la fois « de la poésie et de la musique secrète des mathématiques », « Les conjectures de Buchenwald ». Que j’aurais aimé lire ce texte ! Peut-être y développait-il une sorte de mystique : « J’ai parfois l’impression […] que nous sommes tous reliés les uns aux autres comme une suite de nombres, sans que nous comprenions très bien comment ». La beauté absolue et abstraite des mathématiques, leur incroyable adéquation à décrire le monde, l’une des seules mystiques à laquelle je veux bien adhérer, les soirs de fatigue et quand me saisissent des éclairs de misanthropie.
Souvenirs de mon père, déserteur. Pendant plusieurs années, il a été charpentier à bord de cargos. Je ne sais pas si cette fonction existe encore dans la marine marchande moderne, mais à l’époque dont je parle, dans les années cinquante, en Argentine, chaque cargo avait sur son rôle d’équipage un charpentier. Son travail, outre les aménagements et réparations des pièces en bois, était de mouiller et lever l’ancre et de gérer toutes les clés du bord. Mon père avait émigré du Chili en Argentine lorsqu’il avait une quinzaine d’années. Son père était resté à Valparaiso. Un jour que le bateau de mon père faisait escale dans sa ville natale, il rendit visite à mon grand-père, resté au Chili. Ils étaient attablés en terrasse, une bière posée devant eux, heureux de se revoir. Mon père aimait et admirait le sien autant que moi le mien. Passe une Jeep militaire qui s’arrête devant la terrasse. Contrôle d’identité de tous les clients. Le gendarme s’éloigne avec le livret maritime de mon père et appelle par radio quelque part. Mon grand-père pose une main sur celle de son fils, pris par l’inquiétude que provoque toujours la police lorsqu’elle fouille dans ses obscurs fichiers. Lorsque le sous-officier revient, il ne rend pas le livret à mon père et lui déclare : « Jeune homme, vous devez deux ans de service militaire au pays ». Mon père répond qu’il ne peut pas, qu’un bateau l’attend, qu’il appareille demain, cap à l’ouest, vers le Japon, Osaka, qu’il ne vit pas au Chili… Peine perdue, ils l’embarquent. Incorporé, tondu, uniformisé, il fait ses classes, apprend à tirer, à reconnaître les grades, puis il est affecté à un régiment dans la cordillère des Andes. Il est opérateur radio, un lourd et encombrant dispositif à l’époque, muni de pédales pour générer le courant nécessaire aux onomatopées militaires. Dans la montagne il eut froid et fit du trou, puni à de nombreuses reprises pour indiscipline. Il était antimilitariste par principe, il se confirma par expérience. Ils échangeaient du courrier, avec mon grand-père. À mots couverts, usant de codes connus d’eux seuls, mon père dit au sien son projet de déserter cette folie ; le père approuva. Ils savaient ce que cela impliquait. Un matin à l’aube, je ne sais comment – lui non plus n’en revenait toujours pas, tant d’années après en me racontant cette histoire – il parvint à fausser compagnie aux sentinelles. Chaudement vêtu, sur un cheval sans nom, armé d’un fusil. Sans la maudite radio. Il chercha son chemin parmi les sentiers enneigés, peut-être en regardant le soleil se lever. À l’est, c’était l’Argentine. Il devait éviter les chemins encombrés de douaniers ou de soldats. Quelques jours plus tard, sans avoir été rattrapé, il parvint à traverser la frontière. En descendant dans la vallée après le col, il trouva une petite ferme ; il offrit fusil et cheval au paysan qui l’hébergea, lui partagea matés et le rempluma. Puis il regagna Buenos Aires. Il ne put jamais plus retourner au Chili. Les années suivantes il ne revit que quelques rares fois son père. Lorsque le cargo sur lequel il était embarqué faisait escale à Valparaiso, souvent mouillé au large, sans entrer dans le port, mon père n’en débarquait pas et restait seul à bord. Alors mon grand-père louait une embarcation et venait le trouver à bord. Lorsqu’il mourut, mon père ne naviguait plus.
La fille du mathématicien évoque la difficulté d’écrire sur son père ; difficulté que je vis, je n’écris encore que des anecdotes.
Je finis le livre avec le sentiment diffus que l’humanité porte une malédiction, celle d’ajouter du malheur au malheur, dans un « monde devenu douleur » et qu’en sortir, par l’amour – le déserteur retrouvera l’humanité par le soin –, est un chemin tortueux et incertain.
Déserter
Mathias Énard
Actes Sud, 254 p.
2023