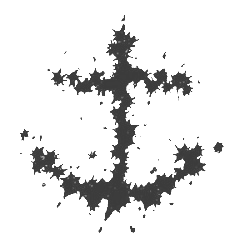La bataille
Un livre de Patrick Rambaud
« – Demain, on va s’entre-tuer au canon dans cette plaine verte. Il y aura beaucoup de rouge, et ce ne seront pas des fleurs. Quand la guerre sera finie…
– Y en aura une autre, mon colonel. La guerre elle sera jamais finie, avec l’Empereur.
– Tu as raison. » (dialogue entre le colonel Lejeune et le voltigeur Vincent Paradis, p. 61)
La bataille, c’était un vieux projet de Balzac. Un livre consacré à la bataille d’Essling que les troupes de Napoléon livrèrent aux Autrichiens en 1809. Mais il ne l’écrivit jamais. Patrick Rambaud, en un geste à la fois filial et présomptueux, l’a écrit, ce roman historique. Une chance pour les lecteurs et la littérature. J’avais lu ce livre à sa sortie en 1997, le brouhaha institutionnel actuel autour de Napoléon m’a donné envie de le relire.
Croisant protagonistes historiques – Napoléon, Massena, Berthier, Molitor, le médecin militaire Percy, Lannes, Beyles alias Stendhal… – et personnages de fiction, c’est la réalité des batailles napoléoniennes qui apparaît. Quarante mille morts sont restés dans la plaine d’Essling. Pour l’Empire, cette bataille est un tournant militaire : l’armée est devenue lourde, lente, alors que Napoléon raisonne encore en rapidité, veut jouer la surprise. Il y aura encore des victoires, mais on peut y voir le début de la fin.
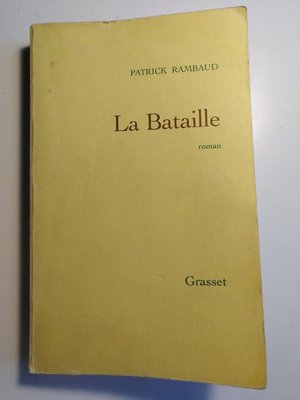 Minutieusement documenté, prenant et réaliste, on y voit les prémices de la guerre moderne, avec son extrême dépendance à la logistique et au génie (l’issue de l’affrontement se joue sur des ponts provisoires jetés au-dessus du Danube en crue). On y assiste aussi à des scènes si horribles qu’elles en deviennent presque comiques, comme ce porte-aigle qui a la tête arrachée par un boulet et dont les économies, des pièces d’or, jaillissent littéralement de sa cravate et se répandent aux pieds de ses camarades (p. 237 – anecdote dont les notes en fin d’ouvrage attestent la réalité). Ceux qui n’avaient pas la tête emportée mais une blessure aux membres risquaient souvent de les perdre : les antibiotiques n’existaient pas, pour éviter les infections les médecins militaires amputaient à tour de bras. Les mains, pieds, bras et les jambes coupées formaient des monticules sanguinolents à côté des tentes de leurs hôpitaux de campagne.
Minutieusement documenté, prenant et réaliste, on y voit les prémices de la guerre moderne, avec son extrême dépendance à la logistique et au génie (l’issue de l’affrontement se joue sur des ponts provisoires jetés au-dessus du Danube en crue). On y assiste aussi à des scènes si horribles qu’elles en deviennent presque comiques, comme ce porte-aigle qui a la tête arrachée par un boulet et dont les économies, des pièces d’or, jaillissent littéralement de sa cravate et se répandent aux pieds de ses camarades (p. 237 – anecdote dont les notes en fin d’ouvrage attestent la réalité). Ceux qui n’avaient pas la tête emportée mais une blessure aux membres risquaient souvent de les perdre : les antibiotiques n’existaient pas, pour éviter les infections les médecins militaires amputaient à tour de bras. Les mains, pieds, bras et les jambes coupées formaient des monticules sanguinolents à côté des tentes de leurs hôpitaux de campagne.
« Les agonisants ne verraient sans doute pas l’aube, ils étaient perdus pour la bataille et pour la vie. Tout près, sous une haie d’ormeaux, les rabatteurs des ambulances avaient disposé une sorte de boutique où ils revendaient pour leur compte les capotes, les sacs, les gibernes, les vêtements glanés dans la plaine sur les cadavres autrichiens et français » (p. 175).
Aussi horribles qu’aient été ces guerres, elles avaient au moins deux vertus par rapport aux guerres modernes : les civils y mourraient moins et les officiers y passaient beaucoup. Il faut dire qu’ils se tenaient souvent aux côtés de leurs hommes, en première ligne. Un engagement qui cessera définitivement en 14-18. Les civils y mourraient moins, mais tout aussi horriblement que maintenant. Une scène insoutenable de meurtre et de viol post-mortem commis par un soldat français ne quittera pas de sitôt l’enfer de mon esprit (p. 76).
Si l’on peut sourire en entendant Napoléon jurer en corse et tyranniser son état-major comme un petit chef de bureau mesquin, la guerre et les chefs militaires, quels qu’en soient les tableaux, les récits, les films ou les romans qu’on en fait, restent détestables : « Des cris abominables montaient du cimetière. Il interrogea. Un lieutenant de la Garde lui répondit que c’étaient des Hongrois qu’on égorgeait à l’arme blanche sur les tombes :
– On ne peut plus s’embarrasser de prisonniers.
– Mais il y en a combien ?
– Sept cents mon général » (p. 231)
La bataille
Patrick Rambaud
Grasset, 302 p.
1997