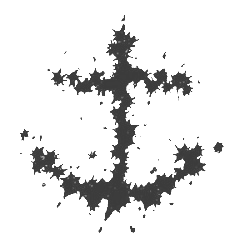Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce
Réflexions sur l’effondrement
Un livre de Corinne Morel Darleux
Abandonner une course n’est pas nécessairement renoncer. En guise d’éloquente illustration, l’exemple du navigateur Bernard Moitessier. Sur le point de gagner la première course autour du monde sans escale, en 1968, il fait demi-tour pour continuer à courir les océans. Plus proche de notre quotidien, ce peut être renoncer à la course aux « loisirs [qui] sont devenus divertissement » (p. 21), à des promotions professionnelles ou, plus fondamentalement, changer de vie pour se trouver plus proche de ses principes. On peut alors se sentir faire partie d’un ensemble plus grand et entrevoir la nature d’un « moi relié et non plus en extériorité », un « soi plus grand » (p. 11). Et se réapproprier sa vie, ce qui est une des plus « grandes jubilations que la vie peut offrir » (p. 42).
Ce petit livre propose d’« inventer une nouvelle frugalité ». En « cessant de coopérer avec le système qui nous broie » (p. 27), la difficulté étant que nous sommes devenus partie intégrante de ce système en l’ayant intégré au plus profond de nos intimités.
C’est un beau texte littéraire, avec des fulgurances exquises : « comme l’amour, le doute est un sentiment humain qui cherche partout son reflet » (p. 61). Ou encore : « Il flotte d’ailleurs parfois en mer comme un parfum de principes et d’honneur qui, je dois l’avouer, n’est pas toujours pour me déplaire et que nous pourrions avantageusement nous réapproprier » (p. 73). Sa vision du monde appelle cette attention à la beauté : « Il existe un lien organique entre l’exposition à la beauté et sa puissance d’émancipation et de dignité » (p. 84). Et « là où le sol s’est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s’éteignent, les esprits s’appauvrissent, la routine et la servilité s’emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort » (citation du géographe anarchiste Élisée Reclus, p. 85).
Comment y arriver ? Essentiellement par le refus de parvenir (vieille tradition du mouvement ouvrier – p. 38), par la volonté de « cesser de nuire », à soi, aux autres, au monde. Convoquant Romain Gary – Les racines du ciel – Morel Darleux ajoute enfin la notion de « dignité du présent », « ce qu’il nous reste de plus sûr face à l’improbabilité de victoires futures » (p. 65). Il s’agit ainsi, en créant une nouvelle éthique d’« organiser le pessimisme » (Émilien Bernard citant Walter Benjamin, p. 69). Ainsi appuyée sur ce triptyque – refus de parvenir, cesser de nuire, dignité du présent (p. 70) – elle met aussi le doigt sur un aspect essentiel : la dimension spirituelle de l’engagement. Les émotions, les principes moraux et les valeurs, trop souvent écartés des considérations et arguments traitant de l’engagement (p. 70), alors qu’elles sont essentielles.
Elle développe une éthique, « une réflexion argumentée en vue du bien-agir » (p. 71) et réhabilite politiquement les « petits gestes individuels », utiles « vers un parcours de radicalisation politique », parce que « personne ne passe directement de la prise de conscience de l’urgence climatique au sabotage des chantiers » (p. 72).
Sur de nombreuses idées, je me suis senti en parfaite affinité. Comme celle de pouvoir choisir ses ancêtres, en particulier pour « convoquer des figures en mesure d’incarner un récit différent de celui relaté par les dominants » (p. 13). Et ses références se posent là : « La Longue Route », de Bernard Moitessier ; la « servitude volontaire » (p. 22), de La Boétie ; Hannah Arendt, « les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action » (p. 25) ; Spinoza et les « passions joyeuses » qui permettent d’augmenter « sa puissance d’être » (p. 33) ; Stig Dagerman et son « besoin de consolation impossible à rassasier » (p. 65) ; Emma Goldman affirmant que les moyens déterminent la fin : « les méthodes révolutionnaires doivent être en harmonie avec les objectifs révolutionnaires » (p. 66).
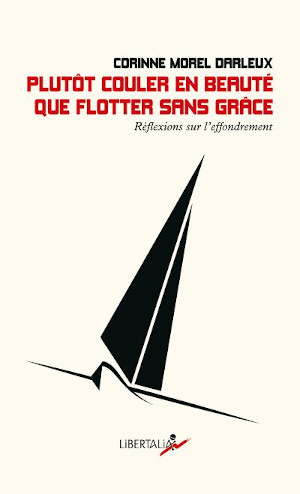 Morel Darleux explicite « le besoin d’un nouvel ordre imaginaire » (p. 77) et la nécessité de « nourrir la puissance d’agir de nouvelles sources d’inspiration pour se reconstruire un horizon » (p. 78). Pourtant, là, ce que j’attendais à la suite n’est pas venu sous sa belle plume : l’évocation d’un nouveau projet de société, dont je m’étonne toujours qu’il suscite aussi peu d’intérêt et d’enthousiasme.
Morel Darleux explicite « le besoin d’un nouvel ordre imaginaire » (p. 77) et la nécessité de « nourrir la puissance d’agir de nouvelles sources d’inspiration pour se reconstruire un horizon » (p. 78). Pourtant, là, ce que j’attendais à la suite n’est pas venu sous sa belle plume : l’évocation d’un nouveau projet de société, dont je m’étonne toujours qu’il suscite aussi peu d’intérêt et d’enthousiasme.
Alors m’est venu le sentiment, désagréable, que ce brillant petit texte s’adressait essentiellement à des bourgeois – plus ou moins enclins à la bohème –, malgré les avertissements de l’auteure (« Louer un mode vie sobre que les pauvres sont obligés de subir […] relève de la faute de classe, de l’indécence », p. 32). Mais les principes et valeurs de la bourgeoisie s’étant largement répandus – c’est-à-dire ayant été adoptés par des millions de gens qui ne sont objectivement pas des bourgeois, essentiellement par l’imaginaire et les pratiques de consommation – le texte parlera à beaucoup.
M’est aussi venue, fugacement, l’idée qu’il pourrait aussi et simultanément s’agir d’un guide de développement personnel pour gauchiste décroissant. Par exemple quand elle se laisse aller à un peu d’essentialisme : « […] C’est aussi réinvestir sa souveraineté d’individu : dire non au système et oui à soi-même » (p. 51 – cette illusion du moi, qui renvoie à une magique nature humaine…). Ce qui aurait pu faire contrepoint et qui m’a manqué, c’est davantage de développements sur l’émancipation organisée de la société, en écho à l’éthique de l’émancipation individuelle. Je pense que ce qu’elle appelle évasivement « politique » (p. 36) ne suffit pas ou, à tout le moins, le type de pratique doit être davantage explicité.
Politiquement, les fondamentaux qu’elle évoque – comme limiter les revenus ou interdire les pratiques inutiles et polluantes (p. 23) – la placent dans la lignée socialiste (qui n’a rien à voir avec les sociaux-démocrates que sont devenus la plupart des partis « socialistes » européens) ; elle dit « écosocialiste ». Quant aux moyens d’action, je serais plus circonspect. Elle dit : « ce dont nous avons besoin n’est pas de former un continent, mais d’archipéliser les îlots de résistance ». Pourtant, elle sait l’impasse d’une écologie « intérieure », dépourvue de conscience de classe (p. 52) et que le « changement par contagion d’exemplarité est une belle histoire » « qui ne fonctionne pas » (p. 54). Bien qu’elle explicite que « la conquête du pouvoir est longue, trop longue face à l’histoire » (p. 57), il m’a semblé qu’elle ne tirait pas jusqu’au bout ce fil, celui de l’organisation et des moyens d’action. Probablement n’était-ce pas le propos.
Un point connexe qui m’éloigne un peu de sa vision politique est l’évocation de « la hiérarchisation des peines du monde [qui] est une arme récurrente pour disqualifier des combats qui seraient pourtant à mener de front » (p. 88 et citation de la cause des éléphants dans les Racines du ciel, qui sont pour Gary une allégorie des droits de l’homme – p. 91). Sans doute est-ce vrai. Néanmoins, on peut ne pas hiérarchiser les peines tout en priorisant les combats. Non pour disqualifier, mais pour maximiser nos chances de l’emporter. Prioriser par tactique, et non parce que l’on considère certains malheurs moins graves que d’autres. Je pense même qu’il est absolument nécessaire de prioriser.
S’il y a une très belle réflexion sur l’héroïsme, idée souvent galvaudée (parce qu’il n’y a pas d’héroïsme sans intention, il n’y a pas d’héroïsme lorsque l’on agit que par réaction, p. 40), il n’y a quasiment pas de réflexion sur la violence. Or penser la violence me paraît essentiel à l’heure d’envisager une autre façon de vivre, en s’élevant contre le capitalisme, et tout aussi indispensable à la conceptualisation de toute éthique.
Malgré les divergences et les quelques absences, c’est un très beau texte qui ouvre l’esprit et suggère délicatement des réponses à des questions qu’un revers de manche ne suffit pas à balayer. Et il donne quelques perspectives incontournables pour nos chaudes années à venir.
Finalement, à propos de « l’effondrement des sociétés » dont « les signes se multiplient ». (p. 75 et 76), elle accroche l’idée d’un nouveau pari de Pascal : « le pari consiste non pas à croire [en l’effondrement], mais à agir : que l’effondrement arrive ou non, nous avons tous à y gagner » (p. 94). Joli et malin, mais je préfère son pessimisme joyeux : « Tant que le pire n’est pas certain, le combattre reste une option » – « Hope dies, action begins » (p. 79).
Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce – Réflexions sur l’effondrement
Corinne Morel Darleux,
Éditions Libertalia, 101 p.
2019