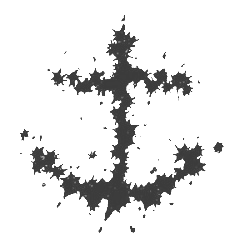Au-delà du classicisme syndical et révolutionnaire
En guise d’introduction
L’objectif de cet article est d’évoquer des pistes pour la prise en compte de quelques faits qui, je trouve, ne sont pas suffisamment considérés : la stabilité du capitalisme en Occident, l’état déliquescent des syndicats, ainsi qu’une ébauche d’explication à l’absence de dynamique de classe en notre faveur, ou le choix de prendre le parti du capitalisme que font tant d’entre nous (le « nous » n’étant pas entendu comme « nous la CNT » ; il marque simplement le fait que je ne me pose pas en analyste impartial, extérieur à la société) ; l’impasse d’années de prosélytisme classique, fondé sur une prétendue rationalité révolutionnaire, ou des raisons de la sécheresse du paysage syndical ; mais aussi l’état charnière, par son absence de sens, dans lequel se trouve le capitalisme et, partant, la société. Enfin, j’évoquerai quelques perspectives, qui pourront peut-être, je l’espère, contribuer à nous mener progressivement, par la contradiction et le débat, à la constitution d’un socle d’idées et de projets qu’une organisation comme la Confédération nationale du travail ne peut évacuer d’un revers de tract aux slogans bien sentis.
Lutte des classes ?
La classe des travailleurs [1], des exploités et des trimards se distingue potentiellement de la classe des détenteurs des capitaux, des écodominants [2], des rentiers. Elle peut s’en distinguer par la possession par les uns des infrastructures de production de biens et de services, des capitaux, et la seule possession par les autres de leur force, temps et énergie de travail, qu’ils doivent vendre pour vivre. L’opposition des travailleurs aux détenteurs de capitaux survient quand les premiers développent, ou tirent de l’oubli, de leur histoire, une conscience de classe [3]. Alors, et seulement alors, la classe des travailleurs prend corps. Tant que nous ne développons pas une conscience de classe et n’allons pas jusqu’à l’opposition et à la lutte envers ceux qui vivent de notre travail, alors notre classe n’existe pas et toute notre activité, salariée ou non, militante ou associative, culturelle ou affective, se noie dans l’élan d’une société où tous les intérêts paraissent soit confondus, soit équivalents.
Que ce soit pour les travailleurs, les exploités mis hors cadre par le chômage de masse ou les écodominants, il convient bien sûr de préciser que conscience et lutte s’alimentent mutuellement et croissent de concert lorsque l’une ou l’autre vient à paraître. Par ailleurs, et pour en finir avec une vision déterministe de l’histoire qu’à mon sens rien ne justifie, il convient également de rappeler que de quelque point de vue que l’on considère la lutte des classes, elle n’est pas en soi révolutionnaire [4] (en effet, voir en un quelconque phénomène humain la prémisse certaine d’un quelconque autre phénomène revient à donner à l’histoire un caractère déterministe, prévisible ; or l’histoire humaine ne se répète pas, ne suit pas le même cours en des circonstances similaires, et nulle théorie, jusqu’à présent, n’a été en mesure de donner la moindre prévision satisfaisante, ce qui serait le propre d’un système déterministe).
Les capitalistes [5], eux, ne perdent jamais de vue leur propre conscience de classe, ce qui, justement, garantit la stabilité du capitalisme par une constante pression de classe.
Une organisation syndicale comme la CNT, naturellement, s’appuie sur cette dynamique de classes, y fonde en partie ses critères d’appartenance, de lutte et ses modalités d’action. Nous nous y appuyons, non par vocation, mais parce que les rapports salariés/employeurs sont aujourd’hui les principaux vecteurs, et de loin, de l’exploitation d’une majorité par une minorité (il ne s’agit pas de vocation en ce sens que, sans doute, nous choisirions d’autres modes d’organisation et d’objets de lutte si l’oppression prenait essentiellement d’autres formes). De fait, c’est là aussi que nous pouvons porter les coups les plus sévères au système capitaliste [6], matrice actuelle de l’exploitation et de l’injustice ; nous y sommes au cœur.
Mais qu’en est-il aujourd’hui, dans notre monde ?
L’apparition du critère de classe comme notion essentielle du mouvement ouvrier et révolutionnaire date d’une époque où l’appartenance de classe, dans nos pays, était criante et physiquement ressentie par une majorité de la population. L’ouvrier, la blanchisseuse ou le gamin commençant sa vie de labeur à 10 ans sentaient au quotidien, dans leur chair, dans leurs os, par l’impact sur leur santé, par l’absence de repos, la pénibilité du travail et l’absence aride d’espoir, l’oppression de la classe de leurs maîtres ; et donc leur appartenance à une classe commune, celle des exploités. La dynamique qui résulte de cette conscience, qu’elle s’exprimât individuellement ou au travers d’organisations, la lutte des classes, était un engagement qui allait de soi pour des millions d’hommes et de femmes.
Aujourd’hui, nous aurons beau écrire les plus solides théories, aligner les plus belles phrases, nous lamenter, pérorer, invoquer le passé ou distribuer autant de tracts aux accents communards que l’Amazonie entière nous permettrait d’en imprimer, la conscience de classe n’est plus ce qu’elle a été lorsque nos aînés ont fondé les organisations révolutionnaires dont nous sommes les héritiers. Logiquement, la lutte des classes s’est sensiblement émoussée ; et nous ne sommes une organisation de masse qu’en principes, aussi considérable que soit le chemin parcouru ces dix dernières années par la CNT.
La capitalisme a eu « l’intelligence » [7], caractéristique de son impressionnante capacité de mutation, de permettre à une large partie de la population d’accéder à des niveaux de vie qui amènent ceux qui s’en contentent à se dire: « Objectivement, j’ai plus intérêt à marcher avec le système, avec le capitalisme, plutôt qu’à me fatiguer à m’y opposer ; quand bien même je sais que ce système repose fondamentalement sur l’inégalité et la compétition ». Par ailleurs, la diffusion, sur tous les modes et sans cesse recommencée, d’une lancinante idéologie visant à nous convaincre que nos intérêts sont ceux de la société telle qu’elle est actuellement organisée, et donc à diluer une éventuelle conscience de classe résiduelle, a accompagné notre mutation de trimards qui espèrent consommer en consommateurs qui espèrent ne plus trimer.
Mais l’essentiel reste que, dans les parties riches du monde, le capitalisme donne à beaucoup la possibilité de s’en sortir individuellement. Pour vivre confortablement, se cultiver, avoir accès aux loisirs, donner un avenir matériel à ses enfants, voyager, étudier… cette possibilité, œuvre souvent de toute une vie mais dont nous ne pouvons nier la réalité, a pris le pas sur la perspective d’un mieux-être qui passerait par une résistance et des conquêtes collectives. Nos pays sont devenus des pays de classes moyennes, dont les membres choisissent délibérément de se plier au système plutôt que de, par exemple, s’impliquer dans une logique syndicale. Bien peu arriveront au but, l’opulence. Une large minorité vivra dans la misère. Mais le capitalisme assure à une large majorité une vie, une perspective matérielle de vie qui écarte a priori le besoin de le mettre en cause. C’est en tout cas ce qui se passe dans la réalité de nos sociétés « avancées ».
Est-il possible de leur expliquer qu’ils ont tort ? Non, parce qu’ils ne se trompent pas. Nous ne nous trompons pas puisque, dans notre immense majorité, même nous qui luttons contre le capitalisme y vivons tant bien que mal. Nous n’émigrons pas, nous n’allons pas tenter l’aventure de quelque vain phalanstère, nous ne braquons pas de banques, nous soignons nos intérêts économiques personnels et ne refusons pas nécessairement un héritage. En d’autres temps, en d’autres lieux, la classe ouvrière a émigré, a versé dans l’illégalisme, a refusé l’accès à la propriété.
Bien sûr, nous sommes aussi des millions à vivre effectivement une exploitation (salariée) ou une exclusion (subventionnée) qui ne laisse aucun espoir matériel, et bien sûr ce nombre augmente ces dernières années avec l’installation du capitalisme mondial dans une phase résolument combative, délocalisatrice et rancunière [8]. Mais il ne s’agit plus de la majorité des travailleurs, en France.
En 2004, nous vivons pour la plupart en tablant sur l’idée que nous avons plus à gagner à collaborer avec le capitalisme, ou au fonctionnement de l’État. Naturellement, de temps en temps, lorsque tel droit ou acquis est remis en cause, ou telle mesure coercitive imposée, cette majorité se rebiffe, entre dans la contestation verbale, d’opinion, électorale, voire dans la lutte sociale ou syndicale sur un sujet précis, et pendant un temps, bien délimité (hors vacances scolaires de préférence).
Mais, à nouveau : il ne s’agit plus que de défense ponctuelle, même si elle peut cristalliser, symboliquement, bien plus. Plus d’engagement avec toute l’âme et de tout son corps, de toutes ses tripes, à la Steinbeck, contre un système que les fourmiliers qui nous servent de philosophes cautionnent sans sourciller (en suggérant par exemple que démocratie est indissociable de libéralisme… lancinante idéologie). D’ailleurs, le fait que la plupart des conflits sociaux soient devenus des luttes de défense d’acquis, c’est-à-dire de droits antérieurement gagnés que les capitalistes ou les États veulent reprendre comme une tranchée perdue, est caractéristique de cet engagement devenu défensif. Et encore, force est de constater que même ces moignons de lutte sociale n’emportent pas toujours la majorité des suffrages.
De fait, il y a là une élégante façon d’expliquer la désaffection continue des syndicats au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Pourquoi irais-je m’engager dans un syndicat alors que je suis lucidement convaincu que j’ai plus à gagner en me conformant au capitalisme ? Et quand bien même, ponctuellement, pour assurer ma défense et faire respecter mes droits, je m’engage dans une logique syndicale [9], pourquoi continuerais-je après, une fois mon affaire perdue ou gagnée ? Et si dans la fonction publique le réflexe syndical est moins écorné que dans le privé, c’est ici encore dû à ce changement d’engagement : dans le privé, les risques pris à se mettre en avant du point de vue syndical ne semblent pas valoir ce qu’on peut y gagner (sauf cas désespéré, c’est-à-dire, bien souvent, trop tard). Non pas qu’il soit inutile de se défendre, bien sûr, c’est entendu ; mais parmi nous, beaucoup font le calcul de s’en sortir mieux individuellement, quitte à jouer la carte syndicale de temps en temps, au besoin. A la carte ; syndicalisme consommé et oublié, au plus offrant. Se voir révoqué de la fonction publique est autrement plus difficile que d’être licencié dans le privé (l’État se doit de « protéger » un minimum ses salariés, quitte à leur assurer un statut leur garantissant une possibilité réelle de contestation), prendre le risque d’un engagement syndical paraît donc plus justifié.
Les derniers grands mouvements sociaux, du printemps dernier à celui de 1995, ont été portés à bout de bras par les salariés de la fonction publique. La perspective des mouvements sociaux n’est plus la révolution mais la sauvegarde des services publics (aussi naïfs et incantatoires qu’aient pu être des slogans comme « Grève générale expropriatrice ! », ils dénotaient une vision que nous n’avons plus ; ou si nous l’avons, qui ne trouve plus guère d’écho). Et ce n’est pas le moindre des paradoxes que d’en venir à défendre, dans les faits sinon en théorie, une certaine idée de l’État [10]. Tout se passe comme si, choisissant de nous plier au capitalisme (le « nous » représentant une majorité, avec laquelle il m’est maintes fois arrivé de lutter et de manifester), nous tenions à conserver les structures collectives de l’État-nation, celui-là même qui se dit impuissant face au capitalisme sans frontières. La défense « d’une certaine idée » des services publics paraît ainsi également le signe d’une défaite : puisque lutter contre le capitalisme est si difficile et offre si peu de perspectives, ce qui n’a pas toujours été le cas puisque pendant des décennies la révolution était imminente dans les esprits des militants sinon dans les faits, tournons-nous vers l’État, dernier bastion qui renferme certaines des promesses que le capitalisme ne sait pas tenir. Ainsi, défendre les services publics est envisageable ; mais empêcher les délocalisations d’usines, les fermetures d’entreprises où se concentrent les savoir-faire, empêcher des licenciements, augmenter les salaires dans le privé, partager les richesses, tout cela paraît lointain, perdu d’avance : les fonctionnaires ne se mobilisent pas à l’aune de leur conscience de classe, puisque la lutte de classe qui en découle suppose une opposition avec les détenteurs de capitaux, avec ceux qui ne bâtissent que pour le profit, ce qui, malgré toutes les politiques de libéralisation de l’État, n’est pas l’essence de ce dernier. Lutter dans le privé, par contre, suppose cette conscience. Ou à défaut, dans le cas où la conscience de classe n’existe qu’en potentialité, une solide raison de s’engager. Une raison qui nous dépasse ; qui dépasse de quelques têtes les seuls intérêts syndicaux ; une raison qui dépasse l’absence de conscience de classe.
Alors les capitalistes ont-ils définitivement gagné ?
Cela signifie-t-il que le capitalisme a gagné ? En serions-nous donc réduits à notre posture de défense, réactionnaire de fait, arc-boutés sur des droits et oublieux des conquêtes, réduits à n’impliquer que les minoritaires surexploités, tous les « sans-quelque chose » et ceux – ils sont nombreux – qui nous rejoignent en étant déjà convaincus de la nécessité de changements de fond ? En serions-nous définitivement réduits à attendre l’intervention des bataillons de fonctionnaires dans la lutte comme la salutaire venue d’un Messie ?
L’Union soviétique n’est plus (ce que les écodominants interprètent comme la victoire du capitalisme, alors qu’il ne s’agit que de la défaite de l’un de ses frères ennemis) ; les syndicats se vident, se ramollissent, font du service à la carte. En guise d’alternatives, nous avons des petits groupes pour lesquels le local est le seul horizon [11] et de gentils militants pour un capitalisme à visage humain [12]. Les socialistes sont irréversiblement devenus sociaux-démocrates et toute forme d’utopie ou de projet de révolution sociale est fustigée comme vecteur d’un nouveau stalinisme. Les marxistes, communistes ou trotskistes, continuent de couler paisiblement, lançant de temps à autres de brusques et vigoureux panaches électoraux, comme les cris d’agonie que lançaient les navires à vapeur en perdition lorsque leurs chaudières brûlantes s’immergeaient dans l’onde noire et que des gerbes blanches jaillissaient en rugissant de la surface de l’océan − leur tombeau (style néo-pompier caractéristique du réalisme socialiste, qui se perd… heureusement).
Et surtout, le capitalisme contente matériellement beaucoup d’Occidentaux. Il semble être devenu l’horizon indépassable. Pour les perspectives, il annonce réalisation par le travail, possibilité d’évolution, sécurité des indemnités de chômage en cas de passage à vide (souvent dérisoires, certes, surtout passée la fatidique limite des « fins de droits », mais dont l’impact comme garantie de paix sociale est réel), possibilité d’ascension sociale et réussite à la force du poignet. Face aux angoisses quotidiennes, de l’enfance à la retraite, il offre à consommer ses mille objets, ses mille spectacles, loisirs et exotismes. Il peut offrir beaucoup en échange du silence, et de la résignation à son absurdité.
Sacrifice obligé, en Occident, il laisse sur le coté des millions de gens, exclus de la grande illusion. Bien sûr, les écarts de revenus entre les très riches et les très pauvres n’a, en France, jamais atteint les sommets actuels. Bien sûr, le chômage n’est pas un passage à vide mais la conséquence d’une habile gestion de la main d’œuvre disponible. Dans le reste du monde, ce sont des milliards d’hommes, de femmes et d’enfants qui croupissent dans la gangue dominatrice de leurs États et de la politique de nos pays. Une organisation comme la nôtre, par essence, regroupe ces sacrifiés ici, tisse des liens avec les exclus et les résistants de ces autres pays.
Mais ici, en France, les quelques mots qui précèdent m’amènent à la conviction que nous ne pourrons réellement devenir une force importante qu’en réussissant à fédérer au-delà de ceux qui nous rejoignent uniquement motivés par la stricte défense de leurs intérêts de classe, exploités jusqu’à l’os ou déjà conscients de la nécessité du réflexe de lutte. En adoptant la posture du seul « syndicalisme radical », à force d’efforts, nous parviendrons à nous développer ; mais nous resterons captifs du faible pourcentage de salariés syndiqués ; nous gagnerons « des parts de marché » sur les autres syndicats et confédérations, tablant sur notre sincérité, leurs trop flagrantes magouilles d’appareils, leur lâcheté, et notre vitalité… mais jamais nous ne changerons pas la société, quelques pour cent restent quelques pour cent.
Dit autrement, tout m’amène à penser que la CNT ne pourra vraiment se développer, devenir puissante, qu’en offrant mieux que le capitalisme, concrètement et aujourd’hui (on me fera remarquer que « mieux » n’est pas approprié, que c’est « un autre futur » que nous voulons… Il s’agit vraiment d’un « mieux », au sens où il doit l’emporter sur la tentation de la collaboration silencieuse au capitalisme). Nous l’avons vu, celui-ci comble objectivement les besoins matériels d’une vaste classe moyenne qui fournit les escouades électorales et dont les enfants versent dans le bénévolat humanitaire. Beaucoup d’entre nous, de ceux qui s’en sortent plus ou moins et font objectivement le choix du capitalisme, sont bien prêts à ne pas penser à la lourde minorité des RMAstes, fins de droits, intérimaires sous-payés et clandestins sans papiers. Quant aux autres, tous ces autres qui peuplent le vaste monde… Ils sont si loin… D’ailleurs, comment m’habillerais-je si bon marché, s’ils ne travaillaient pas tous ces Philippins ? Comment offrirais-je des jouets à des prix si abordables à mes enfants, si les Chinois ne bossaient pas ? Comment pourrais-je envoyer mes mails avec mon ordinateur rutilant, sans toutes ces lointaines petites mains anonymes ?
Je pense que ce que nous avons à offrir ne relève ni de la résignation culpabilisante, ni du service, ni de la verroterie consumériste ; cela relève précisément de ce que le capitalisme que nous combattons ne peut pas offrir ; cela relève de ce que sa seule contestation, aussi juste soit-elle, ne peut pas susciter. Il s’agit de trouver des solutions aux contradictions dans lesquelles nous pousse la société capitaliste, entre consommation, intégration, exclusion, résistance et élans utopiques.
Vivre sans projections ?
Les sociétés, organisées hiérarchiquement, habituées aux destructions des guerres, aux rudesses du labeur, aux aléas des climats, à la sourde souffrance de voir leur dignité piétinée se sont recroquevillées pendant des millénaires autour de leurs religions. Or, le matérialisme acharné de ce dernier siècle est allé jusqu’à rogner ce spirituel et coercitif salut, buvard des désespoirs. Sans le remplacer.
En effet, prisonnier de sa nature mercantile, le capitalisme offre de tout, sauf de la transcendance [13], de l’espérance, du rêve. Peut-être a-t-il pu en offrir, aux temps du plein emploi et de l’industrialisation positiviste. Quand il fallait reconstruire un pays après la guerre et équiper les ménages ; quand il se donnait encore la peine de faire diversion en envoyant des hommes sur la Lune ; quand les enfants maudits de sa bourgeoisie créaient de grands élans artistiques. Sans doute en offre-t-il en Chine, en ce moment : là-bas il peut encore donner de lui-même l’image d’une force de progrès, de bien. Les États-Unis sont en train de la bâtir, leur transcendance : incarner le gendarme assumé du monde n’est pas une vocation n’ayant pour origine que le souci du profit. Ils cherchent à se donner une place dans le monde dont, confusément, ils savent qu’elle les dépasse, et leur donne ainsi une perspective que le frère ennemi soviétique ne leur offre plus. Peut-être le capitalisme peut-il éblouir de-ci de-là, en exhibant ses modèles – footballeurs ou actrices – dont il est d’ailleurs caractéristique qu’il s’agisse de modèles des spectacles qu’offre le capitalisme, et non pas de ses dirigeants. Mais, essentiellement, le capitalisme mondial est dans une phase qui ne donne plus à rêver.
Pour une vie, qu’offre-t-il au mieux ?
Un pavillon en banlieue pour ses vieux jours, un capital pour sa descendance, l’accumulation de souvenirs gravés sur caméra numérique haute définition… si tout se passe bien. Autant de choses qui ne donnent pas sens à une vie. S’il est certain que chacun se le construit en partie, se le donne, ce sens, il est tout aussi certain qu’une société, une civilisation, qui ne s’inscrit dans aucune dynamique autre que matérielle, ne peut que finir par se craqueler et se désintégrer. Et ni le capitalisme ni l’État n’offrent maintenant cet indispensable horizon. À moyen terme, la perspective de remplacer une voiture par une autre ne peut pas combler une vie qu’aucun élan collectif, sain où malsain, ne vient étayer ; d’autant moins lorsque l’abîme de la misère et de l’incertitude se fait si présent, et que l’idée de l’imminence d’une révolution n’existe plus.
Des signes, des craquèlements, on en voit déjà. On ne croit plus, on ne peut plus croire, au capitalisme comme force de progrès (principale justification idéologique du bien-fondé du système capitaliste), on y adhère par intérêt matériel ; les activités spirituelles profanes prolifèrent, prenant l’espace laissé vacant par les religions institutionnelles. Maladivement, on consomme des technologies de plus en plus volatiles, on fait des voyages éclairs et dans le même temps, on se gave d’anxiolytiques, de calmants, de stupéfiants et de gnôle. Les livres promus comme phénomènes littéraires narrent partouzes et « autofictions » avec une grandeur que seule égale la médiocrité du style ; l’impressionnisme est mort, ne reste que la FIAC. En moto ou en fumant, risquer sa propre vie devient difficile, et bientôt les cyclistes devront porter des casques, risque zéro oblige. L’insécurité est partout. Puisque nous n’allons plus nulle part, les horizons se rapprochent, le flux tendu est roi. Puisque ni l’État, ni le capitalisme, ni l’Église, ni le Parti communiste n’offrent plus de projection, au moins, aseptisons tout se disent-ils. Assurons. La sécurité nous occupe, son horizon ne va pas bien loin. Faut-il s’ouvrir au monde ? Alors parlons d’un conflit d’un autre âge, en Palestine, où nous serons certains de ne point apercevoir quelque espoir : à terme, il naîtra un nouvel État, indépendant certes, mais qui emprisonnera nos quelques camarades locaux. Israël aura son alter ego. Un ennemi ?! Peut-être un ennemi nous permettra-t-il de nous souder. Certains choisiront les islamistes abrutis, mâchant avec délectation du « choc des civilisations » ; les autres, sûrs d’en rester confortablement aux mots et aux belles phrases épicées d’angélisme tiers-mondiste, choisiront la fédératrice dénonciation des crétins-chefs nord-américains.
Cette absence de perspective, de transcendance, de projection sur quelque chose qui puisse à la fois nous dépasser et transformer notre société, le capitalisme, en l’état, n’y peut rien. Tout au plus réussira-t-il à s’inventer de nouveaux exutoires, guerres ou « révolutions » technologiques, histoire d’occuper maladroitement l’abîme qui le menace. Jusqu’à ce qu’il comprenne, comme il avait compris le danger du socialisme naissant qui était à l’époque porteur d’autres espoirs que les seuls hochets matérialistes. Alors il se lancera dans quelque mutation d’envergure.
Champ libre
C’est là, je pense, notre chance, comme elle l’a été pour nos aînés, en d’autres temps, en d’autres phases où le capitalisme se cherchait. Nous croyons en quelque chose. Nous croyons que nous pouvons nous organiser de façon beaucoup plus évoluée, vivre mieux, plus justement, plus librement, tous. Nous pouvons aller contre l’entropie, contrairement au capitalisme qui ne produit que pour consommer et jeter, qui dégrade et tue, ne créant du progrès technologique que par effet de bord de sa fuite en avant.
Il ne s’agit évidemment pas de nous imaginer en prédicateurs d’une révolution, reprenant dogmes ou illusions ouvriéristes. Justement pas. Il s’agit, à mon sens, de parvenir à nous donner des perspectives autrement plus riches que le carton-pâte consumériste d’une civilisation à laquelle ne peuvent plus croire que les ahuris (les maîtres eux-mêmes ne peuvent plus y croire ; il est touchant, par exemple, d’entendre de sincères capitalistes nous mettre en garde contre la « désindustrialisation » ou le pouvoir toujours croissant des marchés et des seules logiques financières).
Notre société nous révulse, ses injustices nous rongent ; si nous sommes révolutionnaires, c’est bien parce que nous en avons marre de voir se dérouler encore et encore les mirages réformistes… Mais je crois qu’il nous faut aussi affirmer que nous l’aimons, notre société. Pas sa structure essentiellement hiérarchique, pas la mainmise de l’économie, pas ses structurelles injustices, pas sa grossière démocratie représentative. Mais la société en tant que groupe humain. Si nous avons à lutter, c’est pour cette société : parce qu’elle est nôtre, que nous – travailleurs, salariés ou non, productifs pour le compte d’un capital ou non – la faisons. Elle nous appartient ; et j’en aime certains de ses aspects. Ce n’est pas résignation que d’affirmer cela : c’est au contraire prendre acte d’un état de fait et, ce faisant, asseoir une légitimité. Que ceux qui, à longueur d’éditoriaux et de tracts, s’enferment dans la noirceur systématique, la simple contestation sans perspectives, caractéristique d’un activisme primaire et souvent thérapeutique, que ceux-là partent créer leur paradis loin des hommes. J’aime cette vie, la seule que j’aie, et je n’ai pas le temps de repartir à zéro ; je suis attaché à ma terre, à beaucoup de mes semblables, où que je sois, d’où que je sois, pourvu que je m’y sente bien. Certains d’entre nous crèvent de son injustice, ici ; d’autres en vivent tant bien que mal. Une immense majorité de la population mondiale en crève. Mais presque tous nous y suffoquons, matériellement ou non. Ceux qui aiment notre monde sans y suffoquer, ceux qui, en toute conscience, choisissent d’aimer notre société sans vouloir la changer, ceux-là choisissent un autre camp. Parce que j’y suffoque, je me bats pour ma vie, pour mon monde. Mes idéaux étayent mes espoirs, mais ne fondent pas ma motivation.
Il s’agit aussi, à mon avis, d’en finir avec les théories « économistes » [14] qui réduisent l’exploitation et l’injustice à un système sur lequel nous pourrions statuer rationnellement. Rien de ce qui me motive n’est scientifique : la science traite de la matière, du rationnel, du reproductible ; ou au moins de ce qui peut être objectivé. Je m’adresse aux femmes et aux hommes, camarades, indécis ou ennemis. Laissons aux vestiges du passé l’idée de « convaincre » les gens : les gens savent. Ne serait-il pas temps d’affirmer ce en quoi nous croyons, cessant de pathétiquement essayer de démontrer que nous avons raison ? Les capitalistes ont tout autant raison que nous ; ils partent simplement d’autres présupposés que les nôtres. La conscience de classe, la nôtre, commence par accepter et affirmer, en cela, notre subjectivité. Je crois qu’il nous appartient d’affirmer qu’il n’est pas question de raison, mais de choix. Si nous ne vivons plus, en France et dans notre majorité, l’exploitation telle qu’elle a été, les injustices, la révolte envers les injustices de cette société, nous les ressentons en nos entrailles ; le cerveau vient après. Qui a connu et la plus crasse injustice matérielle et la satisfaction économique d’une vie « normale » me comprendra quand je dis que le mal-être qui nous tenaille n’a pas pour seule origine les injustices matérielles ; qu’aucune croissance économique, aussi forte soit-elle, ne pourra voiler l’infamie de l’injustice institutionnalisée en système respectable. Nous pouvons ne pas crever de faim et pourtant vibrer à en crever de l’état de la société, de l’humanité, de la nature. Nul scientisme n’est plus possible, le socialisme scientifique a fait son œuvre ; nous ne démontrerons pas que nous avons raison. Nous nous révoltons contre l’injustice, donc nous sommes : là commence ma pensée. Nous choisissons de croire en une société meilleure et nous choisissons d’agir pour la réaliser. Que ceux qui veulent aider leur prochain passent leur chemin, aillent remplir leur vie ailleurs : nous n’aidons que nous-mêmes. Ce n’est pas d’un monde meilleur pour mes petits-enfants que je veux ; mon engagement n’est pas désintéressé : je veux un monde meilleur pour moi, de mon vivant (alors, me réplique-t-on souvent, devient capitaliste… ce à quoi je réponds soit par un haussement d’épaules fatigué, soit en rappelant que mes choix engagent l’humanité toute entière, ce qui rend une telle option impossible). Rien ne m’est plus étranger que de prétendre œuvrer pour le Bonheur du Monde.
Je suis convaincu que, si transcendant nous devons être, notre transcendance doit être séculaire. Nous rejoignent ceux que ça touche, nous rejoignent ceux que ça arrange.
Ne devrions-nous pas aussi essayer de moins dépendre de l’ennemi ? Oui, le capitalisme français et européen se fait de plus en plus agressif ; oui, l’État se désengage des services publics ; oui, la sécurité sociale ou l’assurance chômage restreignent chaque jour leur rôle, déjà ténu, de redistribution des revenus ; oui, nous suivons par bien des aspects le chemin qu’a suivi l’Angleterre il y a quelques années. Et alors ? Notre croissance doit-elle dépendre des offensives des patrons ? Et si demain le capitalisme entre dans une phase de croissance, lui ? Retournerons-nous, penauds, à nos chapelles de nostalgiques ? Non. Ce qui me motive ne dépend pas uniquement de l’état conjoncturel de la société. Elle peut être en crise, en croissance, capitaliste, ultralibérale, fasciste ou communiste… tant que certains subissent tandis que d’autres profitent et dominent, je suffoque. Je ne dénonce donc pas une évolution du capitalisme, sur le ton du « vous verrez, nous allons en crever », sur le ton d’un absurde « néolibéralisme » : nous en crevons déjà (nous avons vu « qu’en crever » ne signifie pas nécessairement « crever de faim »), et le capitalisme n’est pas « néo », il mute, simplement. Et je pense que nous devrions devenir davantage responsables de notre destinée ; ne plus vivre aux crochets de la contestation en nous raccrochant aux derniers thèmes « tendance », s’ils n’offrent pas de perspectives.
Ne devrions-nous pas cesser de ressasser les copies usées de discours ouvriéristes qui n’ont plus lieu d’être ? Être dans la posture de l’amant ruminant sa nostalgie, éconduit par une lutte des classes dont l’expression n’est plus que l’ombre d’elle-même… Les incantations ne serviront à rien. Cherchons d’autres approches, d’autres pratiques, d’autres discours.
Ne devrions-nous pas cesser de nous voir en alliés plus ou moins naturels des groupuscules restés pétrifiés par le marxisme, fut-il diffus et honteux, d’opprimés qui n’ont de présentable que cette caractéristique, de l’anarchisme moral et dogmatique ou de l’activisme brownien ? Ne devrions-nous pas sortir de nos communautarismes, s’ils nous entravent ?
Je pense que nous nous trompons en voyant en tout travailleur un camarade, a priori. Certains d’entre eux, on l’a vu, choisissent délibérément le parti du capitalisme à l’exclusion de toute résistance. Tant que nous ferons du syndicalisme, notre critère de regroupement naturel devra rester la conscience de classe, pas l’appartenance de classe (je ne mésestime cependant pas les questions que posent une telle approche. Mais nous y sommes de toutes façons confrontés : il nous faut redéfinir nos critères de regroupement, brouillés par la délitescence de la classe ouvrière). Et là où la conscience de classe n’existe plus, donnons du champ, des perspectives, dessinons notre horizon, abreuvons la soif d’espoir. Mais ne jouons pas inutilement les prédicateurs qui doivent apporter la lumière aux masses, qui doivent « révéler », révéler à l’exploité son exploitation.
Ne devrions-nous pas cesser de nous projeter sur des luttes ou des solidarités qui nous épuisent sans nous offrir aucune perspective viable, c’est-à-dire où, d’une façon ou d’une autre, nos principes et pratiques trouvent quelque écho ? Puisqu’il nous faut maîtriser notre destinée, je pense que nous devons continuer, coûte que coûte – quitte à le fixer comme priorité aux dépens de certaines manifestations ou luttes « sociétales » – notre développement syndical, notre implantation dans le secteur privé : si un jour quelque événement social vient tirer la France ou l’Europe de sa léthargie, alors le secteur privé se sera mobilisé (d’ailleurs, peut-être devra-t-on inventer d’autres formes de regroupement que la classique section syndicale, des formes plus pertinentes face à l’organisation moderne des entreprises). Faisons en sorte de mobiliser des gens qui pourraient faire, autrement, le choix du capitalisme militant ; cristallisons en notre organisation les aspirations à l’utopie que tout homme et toute femme porte, fut-ce en sommeil. Amenons à nous rejoindre à la fois la vaste minorité qui trinque matériellement et la majorité qui s’en sort matériellement mais suffoque.
Puisque je suffoque, il me faut de la créativité, de la perspective et de la vie ; alors allions-nous à des artistes, à des écrivains, des peintres, des musiciens, des cinéastes, des graphistes qui nous sortiraient de notre monacale iconographie ; lançons des conférences, ouvrons des bibliothèques, organisons des cours, des débats ouverts à tous ; drainons du monde, ouvrons des espaces et accompagnons l’émergence de nouveaux élans.
Ne serait-il pas temps de travailler à développer nos projets de société ? Ou bien allons-nous continuer à nous octroyer la paresse de nous référer mot pour mot à ceux de nos aînés ? « Extrême gauche », « Ultra gauche », « Anarchistes » ? « Gauche » ? Qu’ils aillent tous au diable, je n’ai que faire des étiquettes. « Communisme libertaire » ? Le monde a changé depuis Saragosse, nous aussi (contrairement à ce que clame l’un de nos stupides slogans). Sommes-nous trop bêtes pour élaborer nos propres concepts, ceux qui répondraient à la vacuité des temps présents ? Ne voyons-nous pas la chance que nous avons de nous trouver à ce moment charnière du capitalisme, avant qu’il ne réagisse (encore une fois, je ne parle pas de ses conquêtes qui sont, elles, vivaces ; je parle de la réaction qu’il ne manquera pas d’avoir lorsqu’il prendra conscience de l’impasse dans laquelle le mène son manque de perspectives) ? « Autogestion » ? Je suis fatigué de jouer le naïf, feignant d’imaginer que l’autogestion seule peut constituer un programme… Un groupe fascistoïde, une secte, peuvent être autogestionnaires ; l’exploitation peut l’être ; les banques ne seront pas autogérées…
« Mais notre identité est suffisamment claire ! » me direz-vous dans une missive que vous signerez d’un étrange et schizophrénique « Salutations syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndicalistes »…
Nous l’avons vu, le capitalisme se nourrit de sa propre contestation, syndicale ou autre. Alors j’y vois une impasse; « l’anti » et l’activiste chevronné me lassent : luttons « pour », pour notre monde, pour nos droits, pour nous, pour nos projets. Gagnons la place laissée vacante par la simple contestation. Ne nous épuisons plus en agitation désordonnée, construisons l’organisation par l’exemple, les moyens déterminant la fin ; rédigeons nos projets de société, nos nouvelles formulations ; faisons preuve de panache, d’imagination, de classe. Soyons la seule organisation capable d’allier luttes concrètes, syndicalisme d’entreprise et d’action directe, fonctionnement horizontal, et porteuse d’une transcendance que, si nous prêtons l’oreille, nous entendrons le monde réclamer à pleins poumons. Soyons-le dans les faits, pas uniquement en slogans ou en déclarations de principes.
Épilogue
Arrivant au terme de ces quelques lignes, s’il ne devait rester qu’une idée concrète, ce serait la suivante : la perspective, la transcendance, dont j’ai à la fois essayé de montrer l’importance pour nous et l’impossibilité pour le capitalisme à en apporter une quelconque expression dans l’immédiat, je pense que nous pouvons la construire en partie par notre projet de société, duquel découleraient de nouvelles perspectives.
Je pense donc que la CNT devrait mettre en œuvre un tel projet, en se laissant le temps requis par l’ampleur des questions soulevées, mais rapidement ; dans un ou deux ans, lors d’un Congrès confédéral, Extraordinaire ou non, décidons de notre projet de société.
[1] La classe des travailleurs est une vaste et imprécise catégorie regroupant les gens qui, pour vivre, n’ont à vendre que leur force, leur temps, leur imagination, leurs connaissances et leur énergie de travail. Les contours en sont cependant flous, puisque aujourd’hui un PDG rémunéré par un conseil d’administration pourrait être, sur la base de cette seule définition, considéré comme appartenant à cette classe. D’où l’intérêt de considérer que les classes sociales n’existent que si celles et ceux qui les constituent ont une conscience de classe.
[2] Néologisme désignant ceux qui, dans une société donnée, dominent économiquement. La bourgeoisie (bien que ce terme soit lui aussi très imprécis) a la propriété supplémentaire de se perpétuer de génération en génération, et d’atteindre à une stabilité qui lui donne la faculté de se prolonger quelle que soit la crise traversée (sauf peut-être une révolution). En revanche comptent parmi les « écodominants », ceux que l’on désigne parfois comme « nouveaux riches », qui ne sont pas héritiers et n’ont accédé à cette position que par un investissement personnel et un acquiescement total à la logique du plus fort, le capitalisme.
[3] Conscience lucide et assumée d’appartenir à une classe qui partage des intérêts communs. Elle se traduit par des opinions et des comportements sociaux comme la solidarité, les démarches collectives ou la transmission de valeurs communes.
[4] Ne peut être révolutionnaire que la personne ou l’organisation qui œuvre, dans les faits – et pas uniquement en mots ou en concepts – pour un changement profond des structures d’une société : sociales, politiques et économiques. Ainsi, j’ai par exemple du mal à considérer comme révolutionnaire celui ou celle qui s’engage dans une organisation réformiste (politique ou syndicale) garante, qu’on le veuille ou non, de l’ordre actuel. Par ailleurs, peut-être devrions-nous un jour nous départir de ce terme : le sens astronomique de « révolution » étant des plus fâcheux…
[5] Personne qui possède des capitaux et les investit dans les entreprises. Un écodominant (bourgeois ou rentier par exemple) n’est pas nécessairement un capitaliste. A l’inverse, l’actionnariat salarié et l’ouverture de la bourse au grand public peut faire d’un petit porteur salarié ou retraité, qui aurait peut-être pu appartenir à la classe des travailleurs, un capitaliste. Autre contradiction que seuls de nouveaux concepts pourraient lever.
[6] Système économique et social fondé sur la propriété privée des moyens de production et d’échange. Le capitalisme se caractérise par la recherche du profit, l’initiative individuelle et la concurrence. A lire une telle définition, on ne peut s’empêcher de penser au caractère primitif d’un tel mode d’organisation. A y vivre, on le sent.
[7] La personnification est abusive, mais parlante. Il faut, à mon avis, voir le capitalisme comme une sorte d’écosystème dont les paramètres qui en déterminent l’évolution sont nombreux et flexibles. Il connaît peu de dogmes, s’adapte très facilement et absorbe la plupart de ses ennemis pour s’en renforcer ; d’où sa propension à l’expansion et sa résistance (quant à sa longévité… je doute que quelques centaines d’années soient vraiment significatives).
[8] Le capitalisme est aujourd’hui résolument dans une phase rancunière en ce sens qu’il revient à la charge, de toute son énergie, contre des acquis qui ont été soit gagnés de haute lutte par nos aînés pour qui la lutte de classe était une réalité tangible, soit contre des acquis octroyés par les États, soucieux de paix sociale.
[9] Relève de la logique syndicale toute lutte que des travailleurs mènent en commun sur leur lieu de travail pour leurs intérêts économiques et professionnels, indépendamment de toute notion d’organisation ou de label. Je considère que l’utilisation des moyens de pression que notre activité en entreprise nous donne pour avancer nos projets et nos conceptions, au-delà des seules questions économiques, relève également de notre logique syndicale.
[10] L’État est la personnification d’une nation ; il est, essentiellement et en n’en conservant que le cœur irréductible, l’entité politique détenant le monopole de la violence légitime.
[11] L’action locale ciblée et fonctionnant en réseau peut être hautement respectable. Je pense simplement que ce type d’action n’est pas, stratégiquement et dans une optique révolutionnaire, la plus judicieuse. S’il est certain que les individus qui y participent acquièrent une culture, une humanité inestimable, il est tout aussi certain que le slogan « penser global agir local » relève plus de la logique de « marque » que de la pensée politique.
[12] Concernant leur ingénuité, je ne citerai que le paradoxe suivant: une de leurs revendications phares est la taxe dite « Tobin » qui consiste à « reprendre une partie des profits (un pourcentage) de la spéculation pour réparer les dégâts sociaux qu’elle provoque » en les affectant à l’amélioration de la « situation des enfants, des femmes, de la santé publique et de la scolarisation, de la démocratie, de l’environnement et de la sécurité des personnes » dans les pays du sud (citation du site web d’Attac). Soit. Mais, bien que n’étant à leur yeux qu’un outil parmi d’autres, il n’en reste pas moins qu’une telle mesure n’est qu’une régulation qui ne changera pas essentiellement la situation desdits pays. Alors, logiquement, pour augmenter la somme ainsi allouée aux pays du sud pour leur développement, il faudrait augmenter le pourcentage prélevé… et donc militer pour l’accroissement des flux financiers… (pariant sur l’idée qu’une telle taxe ne les abolit pas, mais les restreint).
[13] Entendue comme ce qui est, ou semble être, hors de portée de l’action immédiate et hors de toute détermination de la connaissance. Entendue au sens d’une certaine « mystique », comme Georges Orwell dit que celle du socialisme est l’idée d’égalité (dans Hommage à la Catalogne).
[14] Sont « économistes » les théories ou points de vue qui privilégient les faits économiques dans l’interprétation des phénomènes sociaux et politiques. Ou quand un scientisme d’apparat tente de faire passer l’économie pour autre chose qu’un des multiples moyens par lesquels des êtres humains abusent d’autres êtres humains…
Article paru dans la revue « Les Temps Maudits » de la CNT, numéro 19, mai-septembre 2004.