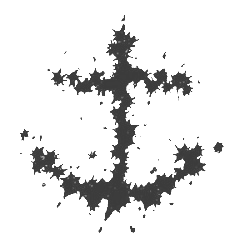Une chance que les taureaux n'aient pas de plumes
Paris, ma si réelle, admirable et détestable capitale regorge de signes.
Il suffit d’y laisser traîner son regard, chaque mur, chaque angle, des toits jusqu’aux souterrains, partout des signes nous parlent en silence. Les rues portent des noms, des publicités criardes clament leurs absurdités, les murs sont barrés d’ubuesques « Interdiction d’afficher, loi du 29 juillet 1881 »…
Si j’écoute au lieu de regarder, les moteurs, sonneries, klaxons, sirènes et conversations parsèment les ruelles et boulevards, appartements et halls de gare.
D’un quartier à l’autre, changeant d’arrondissement, passant du populaire vingtième à l’ouest, septième ou seizième, les immeubles, les rues, les hommes et les femmes, se pareront de signes extérieurs de richesse, de pouvoir, leur allure portera les stigmates de leur classe, de leurs préoccupations et de leurs rêves ou non-rêves respectifs.
D’ailleurs, en allant de ces quartiers populaires à ces antres bourgeoises, combien de panneaux de signalisation aurons-nous suivis ? Aura-t-on vu un bigot, une bigote, se signer devant une église ? Et ces librairies et bouquinistes recelant des myriades de petits objets aux fines tranches blanches couvertes de signes…
Les signes sont partout, font le sens, s’écoulant avec assurance d’une plume tenue par la main gauche et ferme d’une humanité discordante.
J’y vois le signe d’une vie intense, la trace d’une vitalité propre aux capitales ; non qu’une petite ville soit morne et muette ni qu’un village soit silencieux et avare d’expression. Mais, simplement, la variété y est moindre, les changements moins brutaux, les expressions moins prolixes.
Il nage paisiblement sur l’eau plate, laissant en sillage deux faibles vaguelettes soulever la surface.
Signes de vie, de sens, donc, Paris en offre à foison. Bons ou mauvais, explicites ou non, ils peuplent la ville aux côtés de leurs habitants, heureux de savoir ces derniers si discrets. C’est que l’espace manque, l’atmosphère se charge rapidement, une trop forte concentration pourrait nuire. Nuire à la douteuse et impériale esthétique haussmannienne des grandes artères, nuire à la quiétude d’une cité pour qui la Butte aux Cailles n’est plus qu’un quartier à la mode, nuire aux enseignes et bleus deux-tons mugissants.
Serait-ce possible ? La vie, cette vitalité qui paraît être si évidente serait-elle le mirage morbide d’une population ayant abdiqué ? Laisserions-nous « les choses » nous submerger, prendre le pas et se répandre en signes, symboles, nous submerger de la seule façon qu’elles sachent, c’est-à-dire totalement ? Serions-nous à ce point atteints que les pleurs d’un enfant nous gênent plus qu’un quatre par trois vantant les qualités d’un voyage sous les tropiques ?
Oui, assurément.
Il tourne la tête dans ma direction, me fixe de ses yeux sombres sans cesser d’avancer, sans émettre aucun autre son que le léger souffle de sa respiration.
Je caresse des yeux, de l’orée du Luxembourg, le Panthéon. « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante », du signe qui en impose ça. Attention, y’a du beau monde, et respect nous leur devons, à ces pionniers nationaux. Signes ? Tiens, je ne l’avais jamais remarquée cette croix là-haut… Le temple des illustres Français est surmonté d’une croix sans équivoque. Je n’en reviens pas mais décide d’y aller voir de plus près. Il faudrait le tirer de là, le vieux Voltaire. Pas pour lui, pour nous. Des signes, nous en étalons partout, à en vomir, à nous en rendre malades, et jusque dans la dérisoire postérité de laïques idoles nous jouons l’imposture.
Mais aujourd’hui je n’entrerai pas au Panthéon, l’entrée coûte sept euros.
Tout ça nous appartient, mais il est pourtant payant d’y entrer. Ils y ont installé le pendule de Foucault, dont le mouvement lent et régulier, ses caresses au sable immobile sont signes de la rotation de la Terre.
Mais l’absurde Patrie couronne Voltaire d’une croix chrétienne et fait payer au peuple la visite du temple dédié aux hommes qu’elle dit honorer au nom de ce même peuple, fait payer la Terre qui tourne. Signe des temps, signe d’un temps fiduciaire, chose qui est l’indice d’une autre, qui la rappelle ou qui l’annonce…
Loin de moi l’idée d’en appeler aux regrettés temps d’avant (d’avant quoi, d’ailleurs ? D’avant ma naissance, bien sûr, magnifique légitimation d’une gluante résignation…). Ces signes que je perçois, qui me parlent, je les prends simplement pour ce qu’ils sont, aujourd’hui, face à moi. La vigueur du temps qui passe n’exonère pas de l’absolu des faits tels qu’ils sont, en leur présent, avec et par leurs signes, aussi absconse en soit leur langue.
Voyant que je me suis arrêté à l’observer, les pieds au bord de l’eau, juste au bord, il finit par me regarder de face. D’un élégant mouvement, son corps a doucement tourné. L’eau n’est plus secouée que par les échos de sa nage. Il me regarde crânement, ne s’efforçant plus que de flotter sans bouger.
Signe des temps qui passent… en est-il de plus criants que l’histoire même des signes ? Le Louvre, palais d’une autre monarchie, recèle des fragments de ce qu’ont été les premiers signes écrits. Là, juste derrière la vitrine, des cônes et briques en terre cuite couverts de symboles cunéiformes, faits par les Sumériens 2400 ans avant notre ère. Et là, une tablette pictographique de Basse Mésopotamie datant d’environ 3100 ans avant Jésus-Christ.
Je me laisse aller à regarder ces comptes d’apothicaires d’un autre âge, touché. Ces gens, avec des bâtonnets dont l’extrémité était taillée en forme de coin, ont inventé une écriture. Nos signes. Notre « A » par exemple, porte encore la trace graphique de la tête de taureau que son ancêtre représentait. Les signes, peu à peu, se sont simplifiés. Ils ont fini par être entendus comme sons, perdant leur charge symbolique primaire. Et certaines lettres, comme cet alpha, portent encore les vestiges des images qu’elles ont commencé par être. La simplification des signes s’est également accompagnée de la réduction de leur nombre, passant des 900 de l’époque primitive aux environs de 500 vers 2400 avant notre ère. Les signes commençaient à permettre de former des syllabes, ils s’affranchissaient de leur gangue symbolique pour laisser le champ libre à une syntaxe de plus en plus complexe.
La complexité de l’écriture, donc d’une certaine pensée, s’était accompagnée d’une simplification, d’une abstraction de sa représentation, de ses signes.
Je me souvenais alors d’une histoire d’amour, d’une histoire de sensualité et d’attirance. En d’autres temps, en d’autres espèces, elle aurait pu n’être qu’une copulation, primaire et reproductive, chaque image ou signe de l’imaginaire étant le pendant symbolique d’un geste ou d’une position. Mais une certaine abstraction, un équilibre entre âme et phéromones avait rendu l’histoire infiniment plus belle. Faites de codes et de signes inventés, d’une complicité tissée de subtils silences, de sensations et sentiments dits. De potentialités. Dans toute leur simplicité, comme dans leur plus grande complexité. Je me souvenais d’une histoire d’amour au présent.
Le ressouvenir de cette histoire tardait à s’achever, ses évocations descendaient doucement telle une fine poussière qu’on aurait agitée d’un geste de la main. Elle n’en finissait pas de se poser alors que je me trouvais rue de Rivoli. Puis elle disparut en un battement de cil, d’un long cil, aspirée par un démiurge aspirateur. Je me trouvais nez à nez avec un bus, un grand et puissant bus vert dont le flanc portait un panneau publicitaire ou l’armée française me demandait ce que je faisais ces cinq prochaines années. Dépité, je détournais les yeux qui se fixèrent sur une autre publicité, toute en image, composée d’une femme nue et d’une marque de sous-vêtements.
Plus de cinq millénaires de signes pour en être toujours à clamer notre bestialité. L’histoire d’amour dont je m’étais souvenu m’apparut comme un archipel esseulé, perdue dans le chaos d’une civilisation atrophiant l’usage de ses signes à la mesure du sens qu’ils disent.
Nous sommes ainsi restés, lui flottant, moi au bord de l’eau. Il ne bougeait presque plus. Les vestiges ondulants de sa nage venaient mourir à mes pieds, en silence. Unis dans un muet dialogue, nous nous regardions fixement, sans cligner des yeux. Que me dis-tu ? Que dois-je comprendre ? D’ailleurs, peux-tu m’assurer qu’il y a vraiment quelque chose à comprendre ? Ou bien, n’y a-t-il, finalement, que des choix à faire ? Peu à peu, j’eus l’impression qu’il répondait à mes questions. La conviction même. Sans un mot, sans une expression. Simplement pas son corps, par le simple fait d’être.
J’errais ainsi quelques heures à l’ombre des toits de zinc parisiens, déambulant dans le dédale moyenâgeux accoudé à la Seine.
Les signes, représentation simple de réalités complexes, éléments du langage permettant d’associer signifié et signifiant disent tant qu’un sentiment d’étouffement m’envahit peu à peu. Je tentais de m’en défaire en imaginant un monde sans aucun signe, ou ne subsisterait que le signifié, là-haut, au-dessus du ciel lourd, ou bien en bas, bien en-dessous des catacombes. Mais il en était de cette tentative comme de celles consistant à essayer de s’imaginer l’infini : vaine. Sans signes, rien n’est.
Alors j’ouvrais les yeux, et me résignait à me laisser submerger, tant bien que mal. Des méandres d’une parisienne et éternelle histoire d’amour aux trivialités d’une société névrosée de consommation, ces signes me fascinaient, par leur étouffant foisonnement, par leur étonnante diversité. Tous, dans leur ensemble, dans leur intégrité, signifiants d’une civilisation à la fois aimée et détestée.
Immobile sur l’eau, il m’appelait. Il me répondait. Je sentis l’inéluctable me gagner, se répandre en moi. Chaque fibre de mon corps s’emplit en un instant d’une ardeur flamboyante. Je sautais dans l’eau, à pieds joints, tout habillé. Presque immédiatement, le fond gluant du lac de ce feutré bois de Vincennes reçut le fracas de mes pieds. J’avais levé une gerbe d’eau, éclaboussé. Tout. Je levais un genou, l’autre, l’eau retenait ma progression. Je me sentais rire, rire à pleines dents.
Plus rien n’était silence, je ravageais l’eau du lac de ma course folle et désarticulée. Le cygne, mon cygne qui s’était arrêté pour me contempler, qui avait arrêté sa gracieuse nage pour me regarder, mon cygne… mon beau et méchant symbole… mon taureau ailé. Dès mon brusque mouvement, juste avant de toucher l’eau, le cygne avait donné plusieurs vigoureux coups de ses palmes noires, son long cou s’était tendu. Il fendait l’eau rapidement, me lançant des regards inquiets en tournant sa minuscule tête. Je courais toujours, empêtré dans l’eau inerte, je le rattrapais.
Quand je fus à quelque mètres du blanc oiseau, il déploya ses ailes, voulut s’envoler. Mais je plongeais, m’élançais et lui attrapais sa queue plumée.
Il se débattit, je l’enserrais, il cracha, siffla, scheeeeeeeee, je riais et lui saisis le cou. Le tenant maintenant comme une dent, par la racine, le corps sous le bras droit, le long cou dans la main gauche.
Il ne se débattait plus quand je lui arrachais une grande plume immaculée.
En détalant à grands coups de palmes, il ne retourna vers moi qu’une seule fois son poitrail majestueux, me lança un regard atterré.
Je contemplais son éloignement les bras le long du corps, baignant dans l’eau noirâtre jusqu’à la taille.
Je riais silencieusement, je mangeais la grande plume blanche du cygne.